Depuis les débuts publics de ChatGPT en 2022, la puissance de l’IA générative a révolutionné une énorme quantité d’usages, professionnels comme personnels: il n’a fallu que cinq jours à la plateforme pour atteindre le million d’utilisateurs, contre dix mois pour Facebook et trois ans et demi pour Netflix. Aujourd’hui, les modèles d’IA générative sont intégrés à un nombre croissant de produits et de services, ce qui entraîne une croissance exponentielle de la demande pour ces technologies.
L’impact environnemental de l’IA Générative
Comprendre les implications écologiques de l'Intelligence Artificielle et promouvoir une utilisation responsable
Cette croissance a un coût environnemental élevé, dû à trois facteurs principaux :
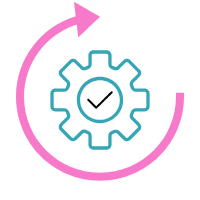
L'énergie requise par les algorithmes eux-mêmes, tant pour leur entraînement que pour leur utilisation

L'eau nécessaire au refroidissement des centres de données
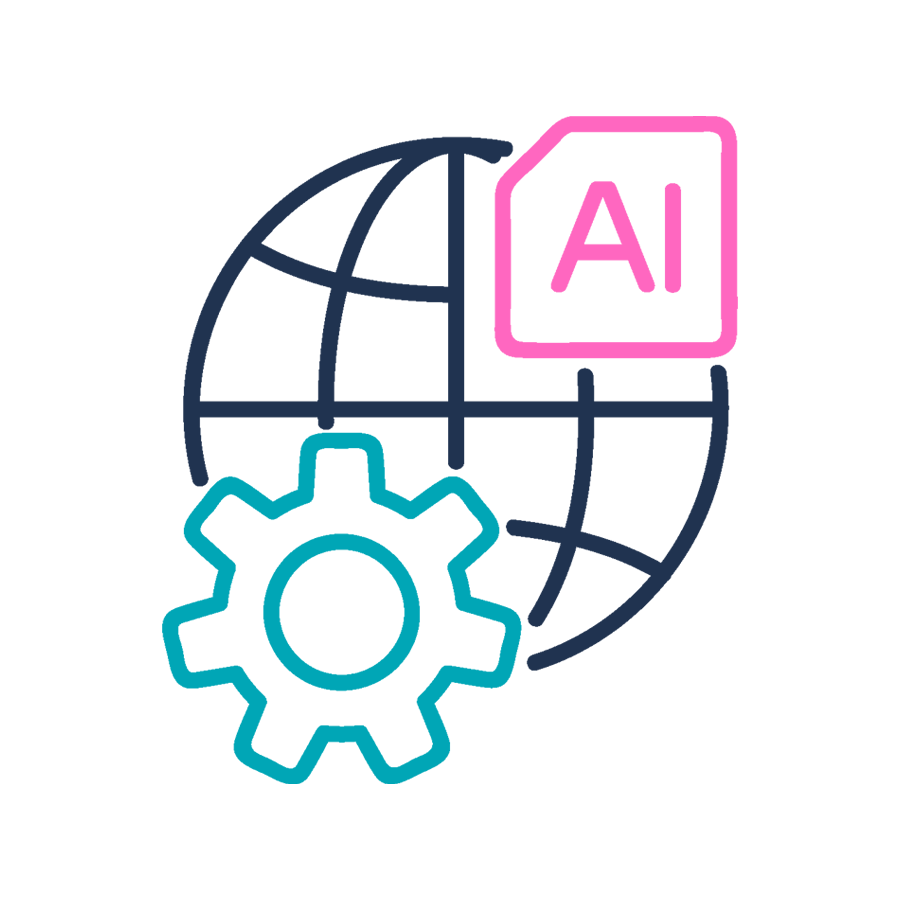
L'impact écologique de la fabrication des puces et des appareils nécessaires au fonctionnement des modèles d'IA
L’empreinte carbone de la consommation énergétique de l'IA
Tout d’abord, analysons la consommation énergétique de l’IA générative.
L’IA générative nécessite des niveaux d’énergie élevés à chaque étape de sa production et de son utilisation, depuis la fabrication des terminaux physiques jusqu’à l’alimentation et au refroidissement des data centers, en passant par l’entraînement des modèles et enfin leur utilisation quotidienne. Chaque étape nécessite une quantité d’énergie considérable, ce qui contribue à son empreinte carbone importante.
Par exemple, l’entrainement du modèle GPT-3 a consommé autant d’énergie que 270 foyers français en un an, en seulement 15 jours. Ce faisant, elle a généré l’équivalent de 552 tonnes de CO2, ce qui équivaut à 200 allers-retours entre Paris et New York.
Et si la phase d’entraînement a historiquement été la partie la plus énergivore du cycle de vie d’un LLM (Large Language Model), la croissance considérable de leur utilisation a désormais fait passer la phase de déploiement (ou d’utilisation quotidienne) des modèles en tête en termes de demande énergétique. À titre de référence, on estime que chaque requête ChatGPT consomme 10 fois plus d’énergie qu’une recherche Google.
Alors à quoi sert cette énergie ?
À alimenter et à refroidir les très grands centres de données qui alimentent les modèles d’IA. La demande en énergie pour les alimenter est si importante qu’aux États-Unis, d’anciennes centrales nucléaires, comme celle tristement célèbre de Three Mile Island, sont réactivées et de nouvelles sont également construites.
Et si l’énergie nucléaire est relativement « propre » en termes d’émissions de CO2 (même si elle pose évidemment d’autres problèmes, comme les déchets nucléaires), la plupart des centres de données IA, situés aux États-Unis, sont actuellement alimentés par des sources d’énergie très polluantes, comme les centrales à charbon.
IA et ressources naturelles : l’eau et les terres rares
L’empreinte carbone est loin d’être la seule préoccupation écologique liée à l’IA. Les puces utilisées pour faire fonctionner les grands modèles d’IA (appelées GPUs, ou Graphics Processing Units) génèrent beaucoup de chaleur. Les centres de données IA nécessitent donc un refroidissement important pour éviter d’endommager le matériel. Ce refroidissement est principalement assuré par l’utilisation de quantités massives d’eau douce extraite de l’environnement local des centres de données, ce qui a un impact dramatique sur les écosystèmes, en particulier dans un contexte mondial de sécheresses croissantes et de pénurie d’eau due au changement climatique. De plus, ces centres de données sont immenses et nécessitent de vastes terrains pour être construits, ce qui représente un autre impact sur l’écosystème.
Enfin, le troisième impact environnemental majeur des modèles d’IA concerne la production des puces physiques et du matériel sur lesquels les modèles sont exécutés. Ces puces, bien que minuscules, nécessitent de grandes quantités de minéraux rares, qui ne peuvent être extraits qu’au prix d’un coût environnemental élevé pour leur écosystème, avec (là encore) de grandes quantités d’eau nécessaires pour préparer, nettoyer et convertir ces minéraux en une forme utilisable, ainsi que dans le processus de construction des composants numériques nécessaires au fonctionnement des modèles d’IA.
De plus, outre le matériel directement nécessaire à l’exécution de ces modèles, les modèles d’IA créent de nouvelles utilisations et de nouveaux produits potentiels pour les consommateurs et stimulent la demande de systèmes informatiques plus puissants, ce qui contribue à la surconsommation et surproduction de nouveaux appareils et de déchets électroniques.
Vers une utilisation responsable de l'IA
Dans le contexte concurrentiel actuel en rapide évolution, l’IA va continuer à se développer. Cependant, adopter une approche réfléchie et respectueuse de l’environnement dans l’utilisation et le développement des modèles d’IA, en particulier les modèles génératifs, est une solution responsable à la portée de tous.
Une façon d’y parvenir, en particulier en tant que data scientist chargé de développer et de mettre en œuvre des solutions d’IA, consiste à s’interroger sur la précision et les performances réellement nécessaires pour que chaque solution fonctionne efficacement. Par exemple, une tâche donnée nécessite-t-elle d’utiliser un modèle d’IA générative (avec une empreinte carbone plus importante), ou existe-t-il un modèle d’IA “traditionnelle” qui pourrait accomplir la tâche ? Une différence de précision de 1 à 2 % aura-t-elle vraiment un impact sur l’utilisation du modèle développé par rapport à son coût environnemental supplémentaire ?
Une autre tactique pour réduire l’impact de l’IA est l’optimisation des “prompts” formulés dans un outil d’IA générative : rédiger un prompt clair dès le début permet de réduire le nombre de requêtes nécessaires (pour ne pas envoyer 5 questions à la suite).
De plus, à mesure que de plus en plus d’études sur l’impact des modèles d’IA sont publiées, il est également possible de comparer l’impact par modèle afin de privilégier l’utilisation de ceux qui sont les plus respectueux de l’environnement.
Enfin, en tant qu'utilisateur, avant de décider d'utiliser un outil d'IA générative pour une tâche, on peut également suivre la méthode BATU et se poser les questions suivantes :
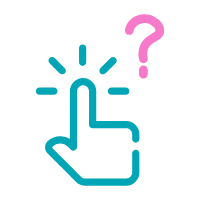
Ai-je Besoin d'utiliser cet outil ?
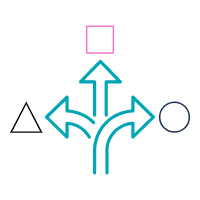
Existe-t-il des Alternatives disponibles ayant un impact environnemental moindre ?
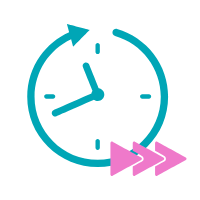
L'utilisation de cet outil me fera-t-elle vraiment gagner du Temps ?

L'utilisation de cet outil sera-t-elle vraiment Utile pour la tâche que j'essaie d'accomplir ?
Pour aller plus loin : ressources complémentaires
Voici quelques ressources utiles pour approfondir le sujet de l’impact environnemental de l’IA :
- Livre blanc “Les grands défis de l’IA générative”, proposé par l’association Data for Good
- Compar:IA, comparateur d’IA conversationnelles, proposé par Beta Gouv
- La Bataille de l’IA, un atelier pour explorer les enjeux sociaux et environnementaux de l’IA Générative
- La Fresque du Numérique, un atelier pour explorer les enjeux environnementaux du numérique
